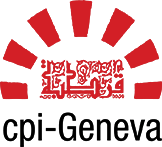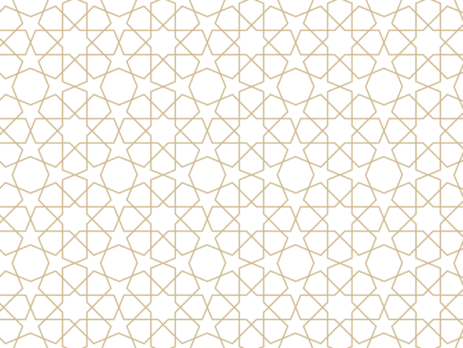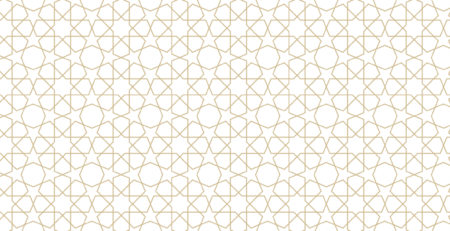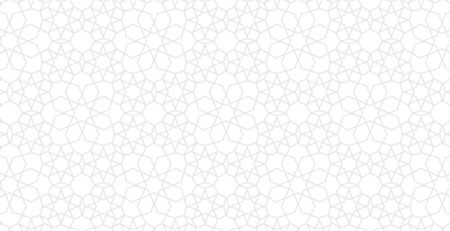Abbas Aroua: Entre Conseil des Droits de l’Homme et Club des Dictateurs Honnis, le CDH cherche sa voie
Il y a une dizaine d’années, l’Algérie vivait sous le rythme des vagues de massacres qui exterminaient des hameaux entiers, avec une passivité, voire une complicité, des dirigeants de l’armée. L’opinion publique mondiale se mobilisât pour faire cesser ces massacres et pour qu’une commission d’enquête experte, indépendante et libre de ses mouvements, se rende en Algérie. Cette demande, soutenue par de nombreuses ONGs ainsi que par le Haut commissaire des Nations unies pour droits de l’homme, Mary Robinson, fut rejetée farouchement par le gouvernement algérien.
A la 54ème session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU au printemps de 1998, une pétition ayant récolté plus de 5000 signatures de par le monde fut remise à la CDH et un sitting fut organisé à la sortie de la salle XVIII du Palais des Nations pour exiger le dépôt d’une résolution sur l’Algérie. Plusieurs chefs de délégations nous avaient assuré qu’ils soutiendraient une action pour l’Algérie si elle devait être décidée ; mais il fallait qu’un pays influent en prenne l’initiative. La CDH a terminé ses travaux sans qu’aucune action concrète concernant le drame algérien ne soit adoptée ; ce fut la déception pour les ONGs des droits de l’homme et les milliers de citoyens qui s’étaient mobilisés. L’Ambassadeur algérien, Mohamed-Salah Dembri, interviendra le 22 avril 1998 devant la CDH pour expliquer que la position de son gouvernement était « fidèle à cette tradition diplomatique qui est propre à l’Algérie depuis l’indépendance de refuser les œuvres périssables et les calculs étriqués pour favoriser les puissantes conjonctions de la communauté internationale sur le terrain du devoir collectif et solidaire ». Ce succès de la diplomatie algérienne était dû principalement à la « solidarité amicale » du groupe des pays africains et au « soutien fraternel » du groupe des pays arabes au sein de la CDH. Lors de son intervention, l’Ambassadeur algérien ne manqua pas de saluer : « L’appui unanime qui nous fut apporté, dans l’expression de nos positions par le monde du Non-alignement et par bien d’autres pays qui n’en sont pas membres, [qui] m’amène ici à m’acquitter d’un devoir de gratitude, de reconnaissance et de remerciements envers ceux qui, d’emblée, comprirent notre démarche et nous apportèrent leur soutien. »
Cet épisode malheureux de l’histoire de la CDH m’a conduit à exprimer ma désillusion vis-à-vis du système onusien, dans une contribution à l’ouvrage An Inquiry into the Algerian Massacres (Hoggar, Genève 1999).
A l’annonce de la création du Conseil des doits de l’homme, l’espoir renaissait de voir la nouvelle instance se détacher des pesanteurs politiques qui paralysaient la CDH. Mais hélas, mon enthousiasme fut de courte durée, car la même volonté de geler l’action onusienne a vite réapparu sous forme d’un groupe de pression formé d’Etats connus pour leur triste performance en matière de protection des droits de l’homme, et à leur tête… l’Etat algérien. Un groupe qui veut « tuer dans l’œuf » l’institution nouvellement créée en rendant inefficaces les rares mécanismes et procédures, hérités de la CDH, qui fonctionnaient à peu près correctement, et en s’attaquant en particulier aux experts indépendants des procédures spéciales.
Le quotidien algérien El Watan, sous la plume de son correspondant à Genève, Amine Djazaïri, soulignait le 30 novembre 2006, pendant la troisième session du CDH et avec beaucoup de fierté, le rôle de l’Algérie au sein du conseil des droits de l’homme pour s’attaquer aux experts indépendants de l’ONU et présentait l’adoption d’une résolution visant à imposer un « Code de conduite » aux expert indépendants comme « une première victoire de l’Algérie au nom des pays africains ».
Dans un entretien récent (Le Temps, 5 avril 2007) sur le Darfour, le chef de la mission algérienne, Idriss Jazairy, « renvoyait l’ascenseur » au gouvernement soudanais. Je suis conscient de la complexité de ce conflit. Que la vérité sur cette question se trouve quelque part entre ce qui est publié dans les rapports émis par les autorités soudanaises et ceux publiés par les chancelleries occidentales, avec les minimisations et exagérations des faits pour des considérations politiques, idéologiques, voire même géopolitiques. C’est d’ailleurs pour cela que nous voulions faire une appréciation de la situation et tenter d’approcher de plus près la réalité. Au début de cette année six ONG d’Europe, d’Amérique latine et du Monde arabe se sont regroupées pour aller au Darfour réaliser une mission d’enquête sur la situation des droits humains. Parmi ces organisations figurait le Centre d’étude des conflits et de la paix de la Fondation Cordoue. A la veille de notre départ nous avons reçu un refus catégorique non motivé des autorités soudanaises. A la même époque, d’autres tentatives ont également échoué, dont le voyage d’une délégation du Conseil des droits de l’homme. Cette attitude n’a fait que renforcer en moi la suspicion que le gouvernement soudanais aurait des choses à cacher concernant les violations des droits des populations musulmanes du Darfour, sous une république prétendument islamique.
Dans le même entretien l’Ambassadeur algérien évoquait la situation algérienne, notamment la question des « disparus », en des termes qui appellent à quelques commentaires.
Je suis heureux que l’Ambassadeur reconnaisse l’existence d’un problème de « disparus » en Algérie. Son prédécesseur nous avait habitués à un négationnisme cynique. En juillet 1998, alors que plus d’une dizaine de milliers de citoyens algériens avaient été disparus, enlevés par l’armée, la police, la gendarmerie et les milices gouvernementales, et au moment où de nombreuses familles de disparus étaient venues à Genève soumettre aux instances onusiennes des centaines de dossiers documentés sur des cas de « disparition », interrogé sur ce thème au journal de la TSR, Mohamed-Salah Dembri avait répondu : « On nous a donné deux noms depuis le début. Deux noms qui ont été avancés, sur lesquels nous avons tout de suite alerté nos autorités pour qu’elles nous donnent des réponses adéquates. Pour voir si ces personnes existent même à l’état civil. Il ne suffit pas de lancer un nom ; il faut prouver d’abord que c’est un citoyen algérien, qu’il existe, qu’il est né quelque part. Il ne suffit pas d’aller se balader dans Genève avec quelques pancartes, des photos fantaisistes, donner des lieux de détention fantaisistes et penser que ça y est, on a défendu les droits de l’homme. »
Mais lorsque Idriss Jazairy affirme que les disparitions « ont été surtout le fait de groupes armés », je pose la question de savoir qui a établi cette vérité ? Et sur la base de quelle investigation ? Sachant que depuis plus de dix ans, nous militons en faveur d’une enquête indépendante, et nous nous confrontons au refus systématique des autorités algériennes.
L’Ambassadeur nous apprend aussi que « les forces de l’ordre en sont aussi responsables à titre individuel » Mais alors quelle mesure a pris son gouvernement contre ces auteurs de crimes ? En a-t-il poursuivi un seul ? N’a-t-il pas au contraire promulgué une « charte pour la paix et la réconciliation nationale » qui glorifie et honore l’ensemble des services de répression, militaires et miliciens, et une ordonnance qui stipule qu’ « aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues », et qui menace d’une peine de 3 à 5 ans de d’emprisonnement tout citoyen qui « par ses déclarations, écrits ou tout autre acte » – un procès par exemple – « porte atteinte au institutions de la République algérienne démocratique et populaire, nuit à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternit l’image de l’Algérie sur le plan international. »
Et lorsque le diplomate algérien affirme que : « Nous avons été parmi les premiers à signer la convention sur les disparus », je me demande s’il pense sérieusement qu’une simple paraphe pourra régler un problème aussi sensible, tragique et complexe que celui des « disparus ». Par ailleurs, puis-je rappeler à M. l’Ambassadeur que la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son Protocole facultatif et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en septembre 1989, au milieu de la « parenthèse démocratique », n’a pas empêché, au lendemain du coup d’état de janvier 1992, la terrible vague de répression au cours de laquelle un quart de million de citoyens ont été tués et des dizaines de milliers ont été torturés.
La comparaison que l’Ambassadeur tente de réfuter, sans que la question ne lui soit posée, entre « les brigades de la mort engagées par les gouvernements d’Amérique latine pour combattre des opposants et la lutte que l’Algérie mène contre les terroristes », est révélatrice du malaise du régime algérien de voir, jour après jour, des témoignages, des analyses, des études académiques, des documentaires démontrer l’implication de certains cercles de l’Armée et des services de renseignements algériens dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, dans le cadre d’une guerre contre insurrectionnelle, et sous couvert de lutte anti-terroriste.
Enfin, le plus cynique dans les propos du diplomate algérien c’est qu’il tente de justifier la « sale guerre » menée contre son peuple par une poignés de généraux sans scrupule, en usant d’arguments farfelus du type : « Il fallait peu pour que l’Algérie soit déstabilisée au point de ressembler à la Somalie. Cela aurait été catastrophique pour la région. »
En décembre 1999, M. Bouteflika a envoyé à Washington, comme ambassadeur, un ami aux qualités de diplomate éprouvées. Après les événements du 11 septembre ce dernier fut chargé de convaincre l’Administration Bush que l’Algérie était le meilleur allié des Etats-Unis dans sa « guerre contre le terrorisme ». Le renforcement, ces dernières années, des relations militaires et sécuritaires entre les deux pays porte à croire qu’il a rempli sa mission. En novembre 2004 le même ambassadeur fut dépêché à Genève pour pallier aux carences des méthodes peu diplomatiques de son prédécesseur et pour reprendre les choses en main au sein de l’ONU des droits de l’homme. Réussira-t-il son pari ?
Il est de l’intérêt des droits de l’homme et du devoir des rares pays qui les défendent et des ONGs et militants qui s’y consacrent, de faire face à cette fronde menée par l’Etat algérien visant à saper les fondements mêmes du CDH pour en faire non pas une « conscience de l’humanité », comme le prétend l’Ambassadeur d’Algérie, mais un instrument sous le contrôle des dictateurs, servant à consacrer la surdité de la communauté internationale aux lamentations des damnés de la Terre.
Abbas Aroua
23 avril 2007