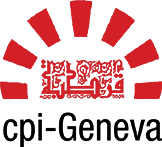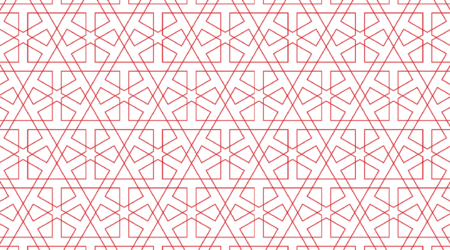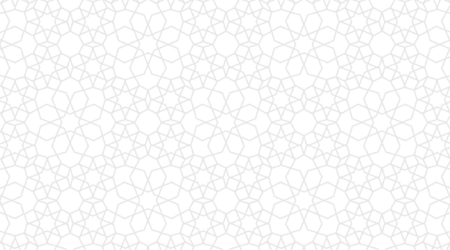A l’occasion du dixième anniversaire du début de la révolution tunisienne

Entretien de CPI avec Maher Zoghlami, chercheur en sociologie en Tunisie.
A l’occasion du dixième anniversaire du début de la révolution tunisienne, que pensez-vous de ce qui a été réalisé jusqu’à aujourd’hui ?
La révolution n’a pas atteint tous ses objectifs, mais la contre-révolution n’a pas non plus gagné. Les acteurs politiques répondent souvent à cette question en pensant que la révolution a atteint une liberté consolidée et ne pouvant plus être restreinte. En fait, je ne sais pas sur quoi ces acteurs fondent ces réponses définitives ! À mon avis, ce qui a été réalisé à partir du seuil de liberté est clair et relativement rassurant, mais les possibilités de revers réactionnaires sont possibles en théorie et en pratique.
Néanmoins, on peut dire que le climat de liberté et d’action politique dans le cadre de la démocratie a été le gain le plus important, par rapport au déficit économique et au manque de justice sociale dans le projet démocratique. C’est aussi ainsi que répondent les acteurs. Je suis d’accord avec ce point de vue, mais les retombées des conséquences de la révolution incomplète ne s’arrêteront pas au déclin économique auquel nous assistons, mais affecteront également la cohésion de la structure sociale.
Quels sont les avantages de la Tunisie par rapport aux autres pays du Printemps Arabe, dont l’issue a été violente ?
Analytiquement, il existe de nombreuses réponses possibles, y compris l’aspect d’avoir été le pionnier. Imaginons par exemple si la Tunisie avait été troisième dans l’effet domino du mouvement révolutionnaire qui a balayé le monde arabe : quel en serait le résultat ?
Il y a une autre hypothèse, dont je ne connais pas la validité, et qui est liée au manque de capacités : des capacités militaires faibles, des ressources naturelles relativement limitées par rapport à la Libye, par exemple. En outre, la Tunisie ne représente pas une menace pour Israël, n’ayant pas de frontières avec lui, contrairement à la Syrie et à l’Égypte.
Cependant, il ne faut pas négliger le rôle crucial de la capacité des acteurs politiques tunisiens de l’époque à assimiler la culture de l’État – quelle que soit la manière dont ils l’ont évaluée. Cette culture s’est pourtant érodée chez ces mêmes acteurs au cours des dix années qui ont suivi. Le plus menaçant de tous est l’entrée de nouveaux acteurs extérieurs au champ politique dans la politique, ce qui menace la politique rationnelle et pourrait saper le projet de transition démocratique.
Comment évaluez-vous la manière dont les élites politiques gèrent leurs différences idéologiques ?
L’idéologie est terminée mais le conflit demeure.
Les élites politiques d’aujourd’hui, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition, ont une courte mémoire idéologique. Il ne reste rien de l’idéologie, mais le terme est utilisé dans les batailles de positionnement et d’intérêts. Cela donne toujours une carte de pression, et je m’attends à que ce soit la carte la plus importante dans la bataille de l’interprétation qui sera déclenchée lors de la création de la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne les questions idéologiquement chargées telles que la liberté de conscience, la protection du sacré, la gestion des affaires religieuses, les libertés individuelles, etc. Le débat ne serait pas dans l’intérêt d’une véritable recherche d’un contrat social et culturel qui fournirait aux gens une sécurité et une orientation spirituelles, mais plutôt une simple question de marchandisage politique qui approfondit les failles sociales.
L’une des crises majeures de l’action politique en Tunisie aujourd’hui est qu’elle est vide de sens. Il n’y a plus de sens en politique. Je vois cela comme un résultat naturel de la lenteur de l’imagination politique et de la léthargie des élites ayant différentes visions du monde à produire les bases intellectuelles nécessaires à l’établissement de leurs projets politiques – les acteurs attribuent généralement cela à la nécessité de l’expertise – comme si la spécialisation et l’expérience contredisaient la pensée ! Par conséquent, la question est de savoir comment les élites politiques gèrent leurs différences ? La réponse est : “Par sous-traitance politique”. La scène politique s’est transformée en un champ de contrats, en raison du déclin de la culture d’État chez les acteurs politiques « classiques ». C’est aussi l’entrée forcée de nouveaux acteurs extérieurs au champ politique et leur occupation de ce champ et jouant selon des règles autres que ses normes.
Pourquoi les efforts contre-révolutionnaires n’ont-ils pas saboté la transition démocratique de la Tunisie ?
Comme je l’ai mentionné, la contre-révolution n’a pas réussi, mais elle n’a pas encore échoué.
L’un des étranges paradoxes est que la contre-révolution, représentant l’expression politique du rejet de la révolution en termes d’existence et de légitimité, est l’un des derniers bastions de l’action politique « rationnelle », même si son projet appelle à la tyrannie et peut-être même à son exercice. Sans aucun doute, ce qui apparaît est un discours populiste, mais derrière cela se trouve une « machine politique classique » qui peut être la même que « la machinerie du parti du Rassemblement [de Ben Ali] dissous » ou qui en est son inspiration la plus proche. Cette expression, quelle que soit sa rhétorique populiste, saisit bien les règles du jeu politique (même si elle est utilisée de la manière la plus malveillante), et est consciente de la portée des acteurs locaux et internationaux. Elle a des stratégies compatibles avec les intérêts des acteurs extérieurs qui interfèrent, et a des alliés dans la bureaucratie, etc. Tout cela apparaît parfois dans la sophistication de la rédaction de certains projets de loi présentés à l’Assemblée des représentants (le parlement).
En revanche, on trouve parmi les forces qui parlent au nom de la révolution et la défendent, des expressions populistes dans leur discours, mais aussi populistes par essence. En ce sens qu’ils sont, d’une part, étrangers à l’action politique, et d’autre part, ils n’ont « pas de machine politique ». En outre, ils n’ont d’autre stratégie que de contourner toutes les règles rationnelles du jeu politique, ce qui leur vaut d’être acceptés par une partie de la base électorale. C’est vraiment compliqué.
La crise politique actuelle entre la présidence, le gouvernement et les partis qui la soutiennent au parlement est-elle une manifestation saine de concurrence politique, ou est-ce la carence la plus visible de la constitution ?
En bref, c’est la manifestation la plus marquante du déséquilibre des normes du champ politique, comme nous l’avons montré précédemment, et les causes les plus claires de l’échec économique accumulé et de ses répercussions sociales. Il n’est en aucun cas possible de surmonter cette crise sans établir une nouvelle charte politique.
Y a-t-il un travail sérieux en termes de politiques publiques pour résoudre les problèmes de développement déséquilibré et d’exclusion sociale et politique, qui ont alimenté le soulèvement il y a dix ans ?
En avril 2020, le Premier ministre Elias Fakhfakh, et une partie de son équipe gouvernementale de l’époque, a organisé une longue réunion au cours de laquelle il a convoqué un groupe d’experts pour étudier la réalité des groupes vulnérables et les répercussions actuelles et possibles de la crise de la Covid-19 sur eux. J’étais parmi les participants et j’avais recommandé de créer une équipe permanente au sein de la présidence du gouvernement pour analyser l’exclusion sociale et concevoir des politiques publiques inclusives (j’invoquais l’exemple britannique).
La façon dont l’ancien premier ministre et son équipe ont interagi avec nos recommandations m’a personnellement inspiré la possibilité d’un travail sérieux au sein de son équipe. La recommandation commençait déjà à avancer, si la scène politique n’avait pas été à nouveau ébranlée, avec les querelles des différents partis politiques, qui ont perturbé les priorités et ont finalement conduit au renversement du gouvernement.
Néanmoins, une équipe en quatre parties a été constituée pour produire un rapport sur les marginalisés, les indications des politiques d’exclusion et d’inclusion. Cette équipe travaille avec des ressources minimales compte tenu de l’instabilité de la scène politique.
L’incapacité de l’État et de ses institutions aujourd’hui, et à la lumière de la situation politique actuelle, à produire des connaissances précises sur les groupes sociaux qui ont été marginalisés pendant des décennies, et l’incapacité à concevoir des politiques publiques liées aux stratégies des programmes de développement, créent de vastes lacunes. Il y a aussi la rivalité malsaine entre les « sectes de la recherche » qui ne sont pas autant intéressées par le champ de la recherche en soi mais en compétition pour le « monopole de l’interprétation » des crises sociales et comment y remédier, dans la même logique de sous-traitance politique dont j’ai parlé plus tôt. En tant que tels, ils passent du statut de référence scientifique, arbitrée et interprétée, à des groupes de recherche qui opèrent à la demande, protégeant leur monopole d’interprétation et essayant de parler au nom des groupes vulnérables.
Nous avons atteint un triple déficit, l’état d’esprit de l’État, l’état d’esprit de l’expertise scientifique et l’état d’esprit de la société civile, qui dépendent tous d’une action politique dénuée de sens et marquée par des rapports de type commercial. Il n’y a pas de solution en vue encore.