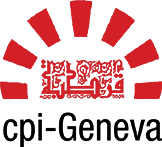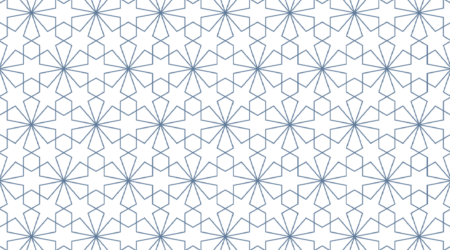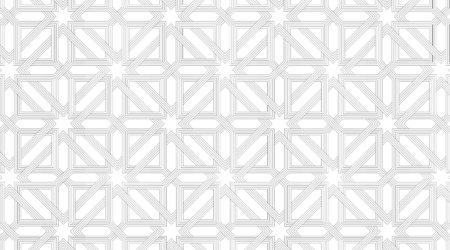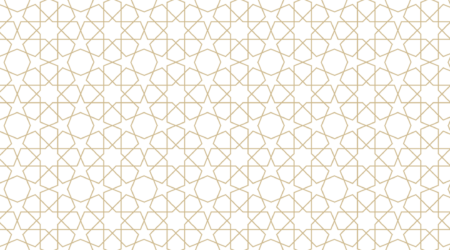Naviguer dans la complexité : Approches du rapatriement et de la réintégration des combattants étrangers du territoire contrôlé par l’État islamique
par Reine Radwan
La réintégration des anciens membres, combattants ou associés de l’État islamique d’Irak et de Grande-Syrie (ISIS) est un concept à multiples facettes qui soulève de nombreuses questions et donne souvent lieu à des discussions où sont utilisés des termes tels que désengagement, démobilisation, déradicalisation, contre-radicalisation et réconciliation. Malgré son importance, il n’existe pas de définition universellement acceptée de ces termes, ni de plans stratégiques pour leur mise en œuvre, ce qui entraîne une ambiguïté quant à leurs limites conceptuelles et à leur applicabilité. De plus, la communauté internationale se trouve à un moment critique pour définir des stratégies efficaces afin de répondre aux défis humanitaires et sécuritaires complexes posés par les détenus et leurs familles appartenant à l’État islamique d’Irak et de Grande-Syrie (ISIS). S’appuyant sur des analyses récentes et des rapports de terrain, cet article identifie trois risques majeurs auxquels sont confrontés les anciens combattants et leurs familles : l’exacerbation de la radicalisation due à des conditions de détention inhumaines ; de graves violations des droits humains et des atteintes à l’éthique ; et l’incapacité des États à assumer leurs responsabilités juridiques et éthiques à l’égard des détenus, en particulier des enfants.
Cet article examine les programmes de retour et de réintégration existants dans trois pays : la France, le Danemark et le Kazakhstan, et évalue leur efficacité. Il se concentre sur les cas où les États décident d’organiser le rapatriement de leurs ressortissants. En analysant ces programmes, l’article vise à contribuer à la compréhension des processus de réintégration et à fournir un aperçu des meilleures pratiques pour gérer le retour des combattants étrangers. Les études de cas sélectionnées présentent des profils variés en termes de processus, d’obstacles et de résultats, ce qui permet une comparaison utile et analytique. L’analyse met finalement en évidence la nécessité de stratégies de réintégration adaptées au contexte local et présente des recommandations concrètes pour combler les lacunes des politiques et pratiques mondiales.
L’approche française se caractérise par un cadre juridique strict qui met l’accent sur la responsabilité, mais soulève des inquiétudes quant à la réinsertion à long terme, à la séparation des mères et de leurs enfants et à l’intégration sociale des personnes reconnues coupables. En revanche, le modèle danois d’Aarhus démontre l’efficacité de l’engagement communautaire au niveau local et de l’adaptation de systèmes de soutien complets pour favoriser la réinsertion et prévenir la radicalisation. On peut citer, à titre d’exemple, la réduction significative du nombre de personnes rejoignant des conflits à l’étranger et la réussite des programmes de réinsertion. La stratégie du Kazakhstan, connue sous le nom d’opération Zhusan, se concentre principalement sur les mesures de sécurité et les considérations géopolitiques. Le pays surveille rigoureusement les frontières pour limiter l’exposition aux réseaux de recrutement en ligne et aux voyages, et réglemente strictement les institutions religieuses. Dans la société kazakhe, les communautés locales ont fait preuve de compassion et les anciens combattants sont perçus de manière moins négative à leur retour, ce qui a facilité leur réintégration.
L’article se termine par une série d’avertissements et de recommandations pour souligner qu’une approche équilibrée et holistique de la réintégration est essentielle pour tous les pays afin d’empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans les camps de l’État islamique en Syrie et en Irak, ce qui pourrait favoriser la radicalisation. Pour atténuer ces risques, les recommandations comprennent la mise en place de programmes de réintégration adaptés, un soutien religieux positif, une solide coordination interagences, un engagement communautaire et un soutien spécialisé pour les femmes et les enfants. Soulignant l’importance de la normalisation et de la priorité accordée à la resocialisation par rapport aux mesures punitives, cet article plaide en faveur d’une approche holistique, fondée sur les droits, pour répondre aux besoins complexes des rapatriés. Ces mesures sont essentielles non seulement pour faire respecter les droits humains fondamentaux, mais aussi pour favoriser la stabilité et la résilience à long terme aux niveaux local, national et mondial.
Lien vers l’article en anglais
Synopsis du papier العربية