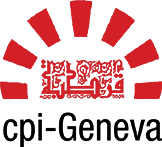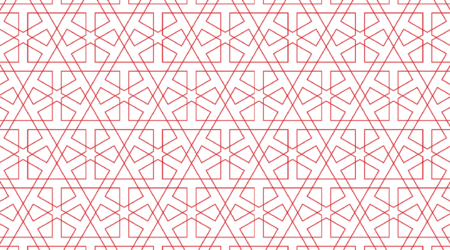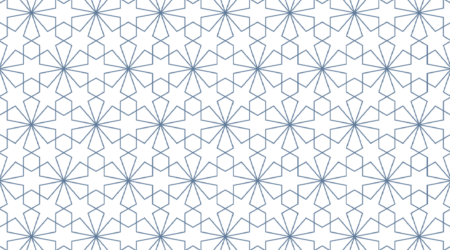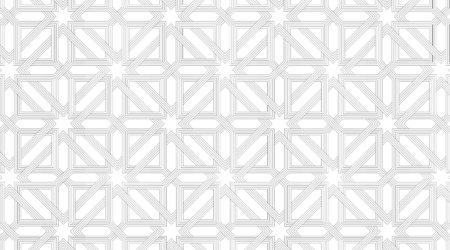Les échanges de jurisprudence islamique comme soutien au processus de médiation
Lakhdar Ghettas English | عربي
Selon le CICR, sur les 450 groupes armés identifiés comme posant un problème humanitaire en 2023, 294 opèrent dans des conflits en Afrique et au Moyen-Orient1. Une note d’information du CICR indique que « la plupart des groupes armés sont prêts à s’engager […] mais les États constituent l’obstacle le plus fréquent à cet engagement [ce qui] va à l’encontre des raisons fréquemment invoquées par les donateurs, les États ou d’autres organisations humanitaires pour expliquer pourquoi ils ne financent pas, ne facilitent pas ou ne tentent même pas de s’engager auprès des groupes armés. »2 Plus de la moitié des conflits armés impliquent aujourd’hui des groupes armés qui expriment leurs intérêts et leurs revendications en termes explicitement islamiques3. [Un nombre important de ces conflits implique des groupes armés djihadistes qui revendiquent une légitimité religieuse basée sur des références islamiques, telles que définies par les érudits religieux de chaque groupe.
Les événements politiques majeurs de 2022 et 2023 ont plongé la région du Sahel dans une situation humanitaire sans précédent. Selon l’aperçu humanitaire d’OCHA de mars 2024, 35,2 millions de personnes vulnérables dans la région, y compris des femmes, des enfants et des hommes, ont besoin d’une assistance humanitaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En outre, la région abrite 5,6 millions de personnes déplacées et 1,7 million de réfugiés4. Cela signifie qu’une personne sur cinq dans le Sahel central a besoin d’aide5. Dans l’ensemble du Sahel central, les décès dus à la violence politique ont augmenté de 38% et les décès de civils de plus de 18%6. Avec l’escalade de la violence dans de nombreux conflits, en particulier dans les régions d’Afrique de l’Ouest, des appels ont été lancés par les communautés et des tentatives ont été faites par les gouvernements, par exemple à Djibo, au Burkina Faso, pour explorer des solutions de médiation visant à réduire les difficultés et les contraintes auxquelles sont confrontées les communautés civiles dans les territoires entièrement ou partiellement sous le contrôle des groupes armés7.
Compte tenu des résultats limités des campagnes militaires en termes de résolution des conflits, des voix au sein des communautés touchées par la violence, ainsi que d’anciens responsables, ont appelé à un changement de cap et à la prise en compte de dialogues qui pourraient conduire à la levée des sièges ou à épargner des civils non combattants dans les conflits en cours8.
S’exprimant à l’Université de Genève le mois dernier, Smail Chergui, ancien commissaire de l’Union africaine pour la paix et la sécurité, a constaté l’échec des approches précédentes visant à stabiliser la région. Malgré les nombreux efforts internationaux et locaux, ces stratégies ont manqué de coordination et de cohérence, ce qui a conduit à des résultats quasi nuls. En réponse, M. Chergui propose une approche globale qui garantisse la sécurité humaine et la dignité des populations. Il insiste notamment sur la nécessité d’impliquer les dirigeants et les autorités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, car leur connaissance des réalités locales est cruciale pour une stabilisation efficace9.
Les acteurs de la paix ont travaillé avec les leaders communautaires et religieux de Track II pour sortir de l’impasse et explorer des solutions locales, basées sur la médiation, aux sièges, aux fermetures d’écoles et à l’accès de l’aide humanitaire. Bon nombre de ces efforts d’engagement ont donné des résultats tangibles en termes de levée des sièges, d’acheminement de l’aide humanitaire ou de réouverture des écoles au Sahel. Cet engagement avec les érudits religieux des groupes armés ayant une référence et une vision du monde islamiques prend la forme d’échanges sur les fondements de la jurisprudence islamique (fiqh). Ils explorent les diverses options offertes par la jurisprudence islamique pour améliorer la situation dans différents contextes de conflit, sur des questions telles que les règles de conduite des hostilités, la gouvernance locale et, en fin de compte, les conditions pour des négociations et des solutions durables par la médiation. Il s’agit d’une sorte de soutien au processus de médiation, similaire à celui entrepris lorsqu’il s’agit d’engager les dirigeants politiques ou militaires de groupes armés avec une vision du monde séculière. Dans ces échanges fiqhis, l’engagement et l’échange ont lieu entre spécialistes du fiqh.
Ce processus soutient les efforts de médiation et de consolidation de la paix en sensibilisant les groupes armés aux diverses options découlant de la jurisprudence islamique pour leurs politiques et leurs actions. Les exemples incluent la responsabilité du bien-être des populations sous le contrôle des insurgés (approvisionnement en nourriture, éducation, services de santé), le droit islamique de la guerre, les attitudes envers les minorités ethniques ou religieuses, et les leçons tirées de la tradition islamique (Sulh al Hudhaybia) pour les termes des cessez-le-feu, des trêves et des accords de paix. La multiplication des options résultant de ces échanges accroît la flexibilité des négociations et empêche le durcissement des positions. La multiplication des options et la prise de conscience des différences entre les contextes de conflit créent plus d’espace pour des solutions durables.
Faciliter les conversations fiqhies entre des érudits musulmans crédibles et influents et des érudits membres (ou proches) des organes consultatifs (Shura) et juridiques (Sharia) des groupes armés d’inspiration religieuse, sur des questions pratiques liées à la gouvernance par exemple, permettra un véritable processus de réinterprétation et de changement dans les attitudes et le comportement de ces groupes vers le non-extrémisme et la non-violence, vers une gouvernance respectueuse de l’ensemble de la population qui est sous leur contrôle, et vers une volonté de dialogue chaque fois que cela est possible.
Le travail de facilitation agit sur la dimension du contexte, en aidant à le comprendre et à le lire. En fait, dans le travail de soutien au processus de médiation, les médiateurs aident souvent les parties à mieux comprendre le contexte (international, local) afin qu’elles puissent prendre des décisions plus éclairées. La facilitation aide également à l’interprétation en fournissant des ressources pour des options d’interprétation supplémentaires, telles que des expériences d’ailleurs et une perspective historique. Elle peut également suggérer des options d’action dans une situation donnée, afin de guider ou d’orienter l’action d’une manière compatible avec le fiqh, la wasatiya et le dialogue.
Les groupes armés d’inspiration religieuse agissent en fonction d’une référence (système de valeurs) qui détermine leur attitude et leur comportement à l’égard des autres. Ils agissent également dans un contexte spécifique, et l’imbrication de la référence et du contexte déclenche un processus d’interprétation sur la manière dont la référence peut être utilisée concrètement pour atteindre l’objectif souhaité10. Le processus d’interprétation (une relecture du système de valeurs qui ne change pas lui-même) est appelé ijtihad dans la tradition islamique. Il produit un cadre juridique qui conditionne les pratiques et les actions des groupes armés d’inspiration religieuse. L’imam Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) définit d’ailleurs l’origine, la voie et le but11. Il est évident qu’à partir d’une même origine (référence), il existe différents chemins (possibilités d’interprétation) pour atteindre le même but recherché. Le chemin, sujet à interprétation, doit servir le but et être en accord avec la référence. Si le moyen est l’action armée, il doit être conforme au droit religieux de la guerre (qui présente de nombreux points communs avec le droit international humanitaire). La conformité à la norme de référence est appelée wasatiya, le contraire de ghuluw (extrémisme)12. [12]
Le processus d’interprétation/ijtihad n’est pas ouvert à tous ; il requiert légitimité et expertise. C’est le rôle et le devoir des érudits islamiques reconnus et crédibles. La (ré)interprétation peut être le résultat de véritables délibérations internes entre érudits au sein ou à proximité de groupes militants. Elle peut également être assistée par une tierce partie, qui doit bien connaître la référence et le contexte, et être perçue par les acteurs comme honnête, juste et impartiale.
CPI a entrepris de tels efforts avec ses partenaires locaux pour explorer les Voies Fiqhies. Cet effort de soutien au processus permet de sensibiliser les décideurs politiques internationaux aux dialogues et aux initiatives de résolution de problèmes fondés sur la jurisprudence islamique qui sont déjà en cours. Enracinés dans une vision du monde différente, les décideurs politiques – ou certaines parties au conflit confrontées à des insurrections islamistes – ont parfois du mal à comprendre la « langue » parlée par les insurgés et ce en quoi ils croient fermement. Les Voies Fiqhies proposent de combler ce fossé dans l’intérêt de la transformation des conflits.
Lakhdar Ghettas
Juin 2024
Références
- Matthew Bamber-Zryd. ICRC engagement with armed groups in 2023. ICRC, Geneva, 10 October 2023. ↩︎
- ICRC Webinar, Global Mapping of Armed Groups, 6 December 2023. ↩︎
- Isak Svensson & Desirée Nilsson. Islamist armed conflicts: A new challenge for conflict resolution? Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, FBA Research-Policy Dialogue on Resolving Islamist Armed Conflicts, October 2021, Stockholm. ↩︎
- OCHA. Sahel Dashboard: Humanitarian Overview. 13 March 2024. ↩︎
- IOM. One in Five People in the Central Sahel Needs Humanitarian Aid: Now is the Time to Act. 12 January 2024. ↩︎
- ACLED. The Sahel: A Deadly New Era in the Decades-Long Conflict. 17 January 2024. ↩︎
- Sam Mednick. Talking to jihadists: How three community leaders took a bold step in Burkina Faso. ‘We discovered that the jihadists have some moral values.’. The New Humanitarian. 25 May 2022. See also:
Sam Mednick. Burkina Faso to support local talks with jihadists: A Q&A with the minister of reconciliation. ‘Everybody wants peace again.’ The New Humanitarian. 27 April 2022. ↩︎ - A Burkinabè community leader. To end the siege on my Burkinabè town, we must open a dialogue with the jihadists. ‘We cannot farm, we cannot raise our livestock, and we cannot trade.’ The New Humanitarian. 8 February 2024. ↩︎
- Smail Chergui, Les nouveaux enjeux de paix et de sécurité dans l’espace Méditerranéen : le cas du Sahel. Public conference. University of Geneva, 2 May 2024. ↩︎
- Abbas Aroua, Jean-Nicolas Bitter, Simon J. A. Mason. The Role of Value Systems in Conflict Resolution. Policy Perspectives. Vol. 9/9. CSS/ETH Zurich. November 2021. ↩︎
- Abbas Aroua. The Origin, the Way and the Goal: Imam Ibn Al-Qayyim’s Typology of Conflict. Cordoba Research Papers. Cordoba Peace Institute – Geneva. June 2023. ↩︎
- Abbas Aroua. Addressing Extremism and Violence: The Importance of Terminology. Cordoba Research Papers. Cordoba Peace Institute – Geneva. January 2018. ↩︎