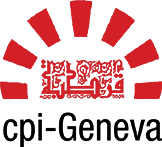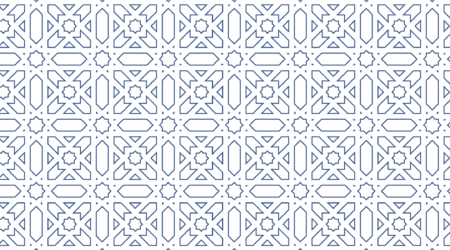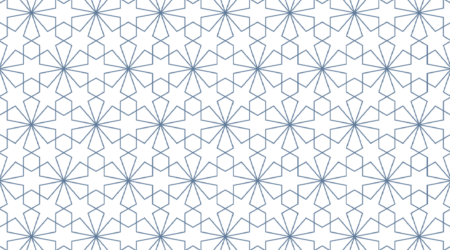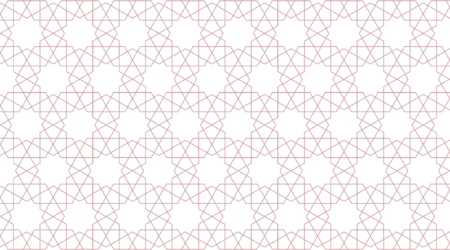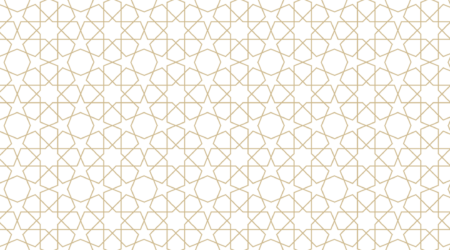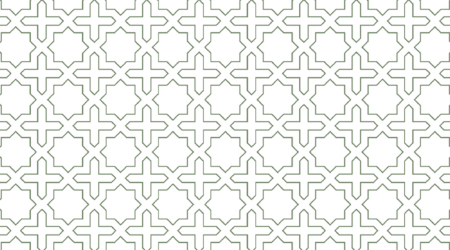D’une crise climatique à une crise de la cohabitation avec le vivant: Comment aborder le conflit entre l’Homme et la nature?
Yaël Bitter English | عربي
Image: L’uomo E La Natura © Agim Sulaj
« Dérèglement climatique », « perte de biodiversité », « augmentation des risques de tensions », « conflits » sont des termes couramment utilisés, pourtant les explications qui sont fournies concernant le lien entre ces phénomènes ne sont pas probantes. De plus en plus de chercheurs analysent les interconnexions entre le climat, l’augmentation du risque de conflits et la paix, et soulignent des faits non négligeables en expliquant par exemple que lors de tensions, le climat est généralement un facteur et non une cause du conflit. Bien que ces analyses soient pertinentes, elles reposent sur un schéma dualiste opposant l’humain et la nature, et abordent les conflits autour du partage des ressources : le changement climatique crée un stress écologique ce qui modifie l’accès aux ressources et crée dans certains cas des conflits.
Une autre manière d’aborder la problématique est une approche systémique plus globale qui consiste à observer les actions déséquilibrées de l’Homme et les réponses de la nature, en retour. Lorsque les ressources sont surexploitées, ce n’est pas que la biodiversité qui souffre mais tout un système complexe qui se déséquilibre. La problématique d’extinction des abeilles est une illustration permettant de faire saillir un rapport de cohabitation vitale entre les actions des humains et des vivants non-humains : les humains ont besoin de l’existence de ces pollinisatrices pour survivre et les abeilles ont besoin que les humains ne détruisent pas leur habitat pour pouvoir continuer à vivre. Il ne s’agit donc plus d’analyser les impacts de l’action de l’Homme sur la nature, mais de comprendre le système dans lequel vit cette nature, ce vivant, non pas pour le protéger ou le dominer en l’exploitant mais pour le traduire dans le langage humain afin de dialoguer et cohabiter.
Une troisième approche aborde les conflits entre Homme et nature autour des notions de traduction et de communication. Les termes « Homme » et « nature » sont substitués par « vivant humain » et « vivant non-humain ». Au lieu de concevoir des liens verticaux entre l’Homme et la nature, avec les humains en haut et le reste des êtres vivants en bas, cette troisième approche permet de reformuler certains concepts pour concevoir des rapports horizontaux entre les êtres vivants sur cette planète et, comme le propose Michael Cronin, « repenser notre identité en termes de rapports horizontaux avec les êtres qui coexistent avec nous. » (Le Temps, 22 mars 2023). Il s’agit ici d’êtres vivants non humains, de cohabitants sur notre Terre, qui se soulèvent et qui exigent que nous négociions des causes communes de la crise que nous vivons, et que nous composions des alliances vitales et communiquions pour élaborer pratiquement les conditions d’une cohabitation optimale.
Nous avons besoin d’une « cohabitation diplomatique », que Baptiste Morizot définit comme étant « un type de récit, une fiction commode, pour raconter quel type de relation envisager envers des êtres qui ne sont plus seulement des ressources, ou des choses, et qui sont entrelacés à nous de manière indiscernable, mais sans y perdre leurs altérités. » (Nouvelles alliances avec la terre. Tracés, 33, 2017). Diplomatie, ou diploma en grec ancien, signifie « plié en deux ». Le diplomate peut être vu comme la personne qui se situe à l’interface entre deux parties hétérogènes, permettant une communication « de monde à monde, de manière d’exister à manière d’exister », pour reprendre les termes de Morizot. Cette personne doit connaître, ou si celles-ci n’existent pas, établir une langue commune, différents modes et codes de communication. Elle peut être considérée comme un traducteur, un diplomate ou encore un médiateur. Son rôle est d’établir un dialogue entre deux parties qui existent sans réussir à coexister. C’est une personne qui, in fine, traduit deux visions du monde, et qui vient apporter des outils pour transformer et résoudre un conflit.
Sommes-nous en train de vivre une crise écologique et sociétale ? Ou sommes-nous en train de vivre une crise de notre relation aux vivants non-humains ? Si nous approchons la problématique à travers le deuxième paradigme, soit une crise de notre relation aux vivants non-humains, l’approche de la transformation de conflit devient centrale. Un conflit peut se définir comme une contradiction, réelle ou perçue, des buts d’individus ou de groupes, que ce soit au niveau des intérêts ou des valeurs. Si les conflits ne sont pas traités, ils peuvent dégénérer vers de la violence. Ainsi, il serait judicieux d’étendre cette définition au conflit entre vivants-humains et vivants non-humains. Dans ce contexte, on peut penser à une médiation interne où l’humain serait un médiateur interne au conflit. Il devrait alors porter deux casquettes en ayant le devoir de prendre parti puis d’être impartial dans son rôle de médiateur.
Est-ce qu’un tel rôle, un tel engagement, est envisageable dans le conflit entre vivants humains et vivants non-humains ? Comment cet engagement prendrait-il forme dans la pratique ? C’est à ce genre de questions qu’on devrait répondre si on veut éviter que ce conflit ne dégénère en violence incontrôlable et ne devienne une menace existentielle pour toutes les parties.
Yaël Bitter
Mai 2024