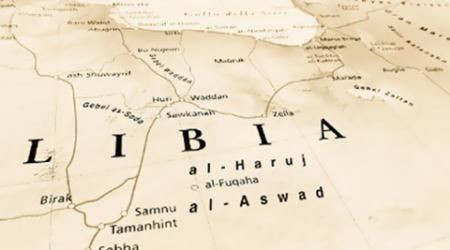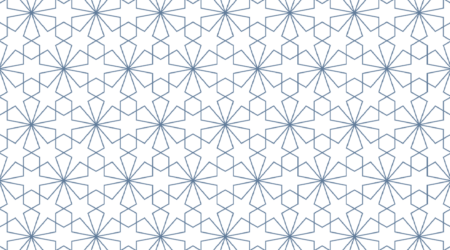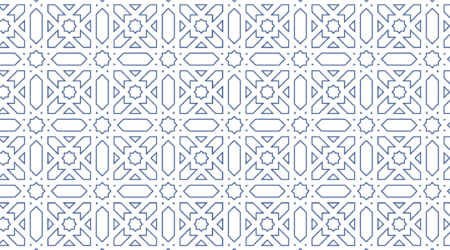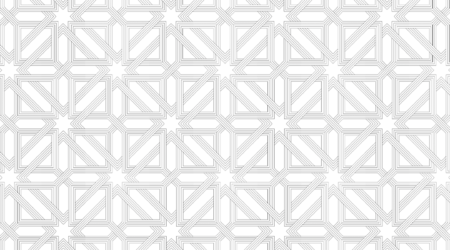CPI en Irak

Après des années de conflits, l’Irak est entré dans une phase de reconstruction et de réconciliation. Bien que l’Etat Islamique (EI) ait été vaincu, et les territoires reconquis, les plaies à panser avant de pouvoir atteindre une paix durable sont encore nombreuses. En effet, la violence et l’amplitude du conflit ont contribué à diviser la société irakienne et agrandir la méfiance entre les différentes communautés..
Kilian Bello et Charlotte Mounier
L’Irak post-conflit
Après des années de conflits, l’Irak est entré dans une phase de reconstruction et de réconciliation. Bien que l’Etat Islamique (EI) ait été vaincu, et les territoires reconquis, les plaies à panser avant de pouvoir atteindre une paix durable sont encore nombreuses. En effet, la violence et l’amplitude du conflit ont contribué à diviser la société irakienne et agrandir la méfiance entre les différentes communautés.
D’après les chiffres de l’OIM publiés en juillet 2021, près de 1,2 millions d’Irakiens sont encore des déplacés internes (1), tandis que l’UNHCR estime à environ 250’000 le nombre d’Irakiens réfugiés dans des Etats alentours (2). Ces déplacés et réfugiés font face à plusieurs obstacles compliquant leur retour, tels que les barrières administratives, la destruction de leur domicile, le manque de services publics, ou encore la peur de représailles s’ils venaient à rentrer. En effet, les personnes ayant décidé de partir sont souvent assimilées par leur communauté d’origine aux Irakiens ayant entretenu des liens avec l’EI et ayant par conséquent fui par peur de devoir faire face à la justice. Une importante fracture existe donc entre les Irakiens ayant choisi de rester et ceux qui avaient quitté et qui souhaitent aujourd’hui revenir dans leur ville ou village d’origine, créant ainsi un climat de méfiance dans la société, ce qui conduit parfois à des actes de violence (3). Ainsi, les habitants des communautés hôtes craignent que le retour des déplacés entraine également le retour d’éléments de l’EI et donc une reprise des violences, tandis que les déplacés évitent de rentrer par peur de subir des représailles. Cette situation entraine un blocage du possible retour des personnes ayant fui les combats et empêche toute solution durable sur le long terme pour ceux souhaitant à présent rentrer chez eux. L’exemple du district de Talafar est parlant, en effet selon un rapport de l’OIM, 81% des personnes souhaitant y retourner n’osent pas le faire tant qu’un processus de réconciliation n’aura pas eu lieu (4).
En plus de ce nombre élevé de personnes déplacées, la guerre a également mené à la disparition d’un nombre considérable de personnes. Ces disparitions forcées sont le fait de groupes armés tels que l’EI, qui a kidnappé et mené des tueries de masse dans les territoires qui étaient alors sous son contrôle. Cependant, ces disparitions ne sont pas attribuées uniquement à l’EI. En effet, pour faire face à l’EI, se sont constitués en Irak des groupes armés réunis sous la nomination des « Forces Populaires de Mobilisation » (FPM). Mais bien que le but premier de ces groupes fût de combattre l’EI, ils ont continué à exister malgré la fin de la guerre. L’important pouvoir gagné par ces derniers a mené à une vague de méfiance dans la population, causée par les crimes et les violences que certaines factions des FPM sont accusées d’avoir commis, tels que des disparitions forcées. En effet, un rapport conjoint de l’United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) dénonce les disparitions forcées d’hommes et de garçons perpétrées par des factions des FPM dans les régions qui ont été sous leur contrôle durant la guerre (5).
Le programme de CPI en Irak
Face à ce climat de méfiance, le Cordoba Peace Institute – Geneva (CPI), a lancé un programme visant à rétablir la confiance et encourager le dialogue entre différents acteurs irakiens, en utilisant la méthodologie de diapraxis, consistant en un processus de dialogue renforcé par le lancement d’initiatives mises en place conjointement par les différentes parties. Offrir l’opportunité à ces parties de se rencontrer dans un espace protégé, organisé par un acteur neutre, permet d’établir entre elles la confiance et de transformer leurs paroles en actions concrètes.
Ce programme est constitué de deux projets :
Le premier projet vise à établir un moyen d’échange entre réfugiés et locaux afin que la confiance puisse être rétablie entre les deux groupes et à développer un mécanisme de retour volontaire et durable. Il a été décidé que cela serait fait via l’organisation d’ateliers réunissant des acteurs influents représentants les parties concernées. Il a également été décidé de se concentrer sur le retour des anciens habitants de Talafar aujourd’hui réfugiés en Turquie, principalement dans les alentours d’Ankara.
Le deuxième projet cherche à établir un consensus inter-religieux quant à l’importance de traiter la question des personnes disparues dû au conflit et la nécessité de partager les informations pouvant aider à connaitre leur sort ou leur emplacement actuel. Ici également, le projet consiste à rassembler des personnes possédant une influence dans la société irakienne, notamment d’un point de vue religieux, afin qu’ils discutent de la question et, idéalement, lancent une initiative conjointe pouvant contribuer à la résolution de ce problème. Collaborer avec ces personnalités influentes permet aux résultats de ces discussions d’atteindre de larges couches de la société et de favoriser l’adhésion de la population aux accords conclus.
Le programme porté par CPI en Irak permet donc d’aborder deux problèmes que la fin de la guerre à elle seule ne peut régler. Il est aujourd’hui essentiel d’offrir aux différents acteurs un moyen de se rencontrer pour pouvoir échanger leurs points de vue, se comprendre, et faire évoluer leurs discours respectifs.
Des discussions riches
Après une phase préparatoire faite de rencontres bilatérales entre CPI et différents experts, personnalités religieuses, et chefs tribaux, un premier atelier a eu lieu les 25 et 26 mars 2021 à Erbil pour aborder la thématique des personnes disparues. L’atelier a réuni 15 participants, dont des chefs tribaux, des experts du droit international humanitaire (DIH), des membres des services de sécurité irakiens, et des leaders religieux. Un deuxième atelier sur le même thème a été organisé quelques mois plus tard, les 12 et 13 août 2021, de nouveau à Erbil. Ce deuxième atelier a réuni 17 participants, majoritairement des leaders religieux de différentes traditions et des experts en DIH. Ces deux rencontres ont permis des échanges stimulants et des propositions ingénieuses pour répondre à la question des disparitions forcées.
L’ensemble des participants ont salué le projet de CPI, mettant en avant, à l’aide de chiffres ou d’exemples personnels, la marque importante laissée par les disparitions forcées dans la société irakienne. Découvrir ce qu’il est advenu des disparus leur parait être un élément essentiel du processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Irak. Plusieurs participants ont exprimé leur frustration et leur mécontentement du fait que la question des disparitions n’ait pas été prise au sérieux par le gouvernement irakien. En effet, de nombreux charniers n’ont pas encore été investigués par les autorités irakiennes et le cadre légal concernant ces disparitions n’est pas encore clairement défini. Néanmoins, les participants ont tenu à insister sur le rôle que devait jouer le gouvernement sur cette question, et leur devoir de mettre le gouvernement sous pression afin qu’il prenne enfin les choses en main. Dans la même ligne, de nombreux appels ont été lancés aux représentants religieux leur demandant d’user de leur influence afin de sensibiliser l’opinion public à ce sujet et de promouvoir des mesures plus importantes de la part du gouvernement.
Grâce à ces discussions, des leaders religieux représentant les différentes confessions présentes en Irak ont pu aborder le sujet des personnes disparues et s’accorder sur la nécessité de prendre la parole face à ce sujet afin que plus de ressources lui soient accordées. L’influence des leaders religieux en Irak étant particulièrement grande, une augmentation de la pression mise sur le gouvernement à ce sujet de leur part a de fortes chances d’avoir un effet positif sur l’attention qui lui est porté. Les réunions ont permis de lancer le projet pratique de formation d’un comité constitué de leaders religieux, d’experts en DIH et de représentants de l’Etat, qui se chargerait de la récolte d’informations concernant les personnes disparues et de la promotion du partage d’informations relatives à leur sort. Ainsi, ces ateliers n’ont pas seulement débouché sur des paroles mais sur de véritables actions conjointes entre les différents acteurs réunis.
En ce qui concerne le deuxième projet du programme, un premier atelier a été organisé les 5 et 6 juin 2021 à Ankara. Il a réuni trois groupes de personnes : des représentants de la communauté Talafari aujourd’hui réfugiés en Turquie, des représentants des habitants de Talafar, et des représentants du gouvernement irakien. Cette première rencontre a permis à chacun des groupes de découvrir et de comparer leur vision des choses à celle de l’autre. Les représentants des réfugiés ont pu ainsi expliquer leur réticence à rentrer, notamment la peur d’être vu par le reste de la communauté comme affilié à l’EI et donc d’être potentiellement sujet à des tentatives de vengeance. Le deuxième groupe de représentants des habitants de Talafar a aussi pu exprimer ses inquiétudes face à la possibilité que des anciens partisans de l’EI puissent faire partie de ces personnes retournant à Talafar. Afin de remédier à cette méfiance mutuelle, les participants ont mis en évidence le besoin d’adhérer à l’identité Talafari et au danger que pouvait mener les politiques sectaires prônées par certains politiciens irakiens.
Le projet portant sur le retour des réfugiés a également été un succès. Comme expliqué, la méfiance existante entre réfugiés et personnes étant restées est importante. Malgré ces tensions, un climat de confiance a rapidement pu se créer entre les participants des différents groupes, qui ont pu parler des craintes liées à l’autre sans que cela ne crée de difficultés. Ici également, une initiative prometteuse a vu le jour, et un mécanisme de retour pour les familles souhaitant revenir à Talafar a été mis en place grâce à la coopération et l’esprit d’initiative dont ont fait preuve les participants présents lors de ces ateliers. Ce mécanisme a pu être testé et 25 familles réfugiées en Turquie ont pu retourner à Talafar en août 2021 [ Video ![]() ]. Cela a été possible, grâce à la participation effective des autorités irakiennes, et grâce au processus de construction de la confiance qui a permis à ces familles d’oser entreprendre les démarches de retour.
]. Cela a été possible, grâce à la participation effective des autorités irakiennes, et grâce au processus de construction de la confiance qui a permis à ces familles d’oser entreprendre les démarches de retour.
Un progrès encourageant
L’initiative lancée par CPI a été grandement saluée par les participants. Les premiers ateliers ont permis le démarrage d’un processus de construction de la confiance entre les différentes parties et à créer des liens entre ces représentants communautaires. La mise à disposition d’un lieu de discussion par un acteur neutre et crédible, où chacun peut parler librement de ses inquiétudes et présenter calmement son point de vue à l’autre, a sans doute facilité l’échange d’informations. Chaque partie a ainsi pu clairement exposer ses craintes, ses envies et ses réticences, tout en étant à l’écoute de l’autre. Ces discussions ont permis de faire des avancées majeures et prometteuses dans chacun des projets concernés par le programme.
Ce genre d’actions conjointe entre différents acteurs est exactement le but recherché par les projets de CPI utilisant la méthode du diapraxis. Ce départ d’envergure nous permet donc d’être particulièrement optimiste quant à l’avenir du programme.
Kilian Bello et Charlotte Mounier
Références
(1) https://dtm.iom.int/iraq
(2) https://www.unrefugees.org/emergencies/iraq/
(3) Managing Return in Anbar: Community Responses to the Return of IDPs with Perceived Affiliation, IOM, 2020.
(4) Home Again? Categorising Obstacles to Returnee Reintegration in Iraq, IOM, 2021.
(5) Enforced disappearances from Anbar governorate 2015-2016: Accountability for victims and the right to truth, UNAMI and OHCHR, 2020.